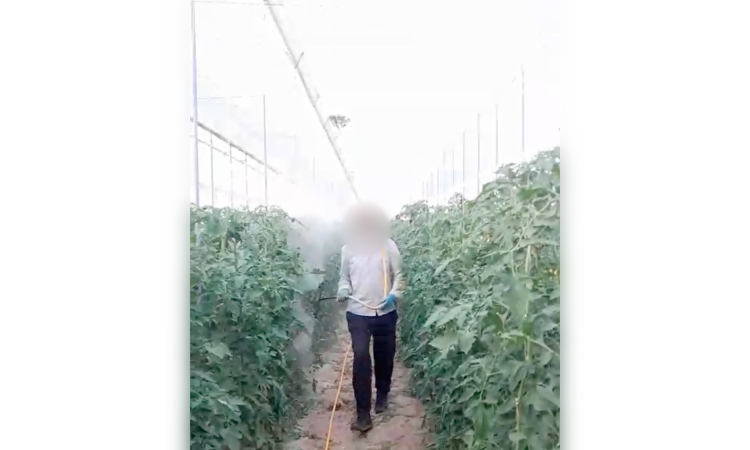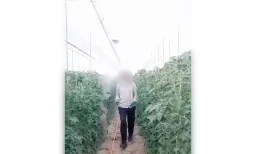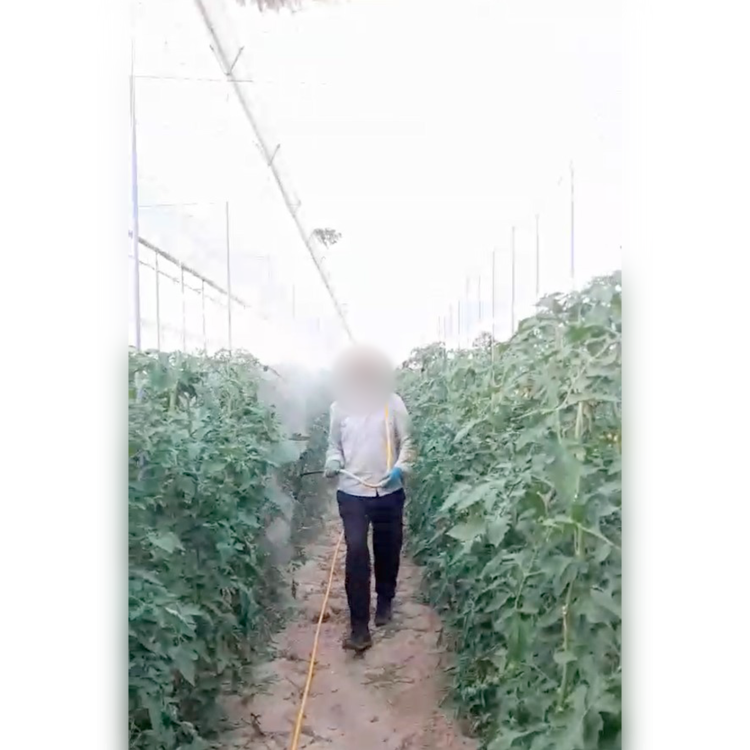Surmédicalisation
«Trop de traitements inutiles»
Archive · 28 janvier 2014

Les gens bien portants seraient-ils des malades qui s’ignorent? La question, tirée de la comédie Knock ou le triomphe de la médecine, de Jules Romain, illustre ironiquement un paradoxe des sociétés riches: la médecine de pointe créerait de nouveaux malades à foison, faisant exploser les coûts de la santé – les traitements et les diagnostics superflus sont évalués à 200 milliards de dollars par an dans le monde. En 2013, la France estimait à 28% le taux de bilans complémentaires inutiles. Les causes de cette surabondance de soins sont multiples: parmi elles, citons les progrès technologiques, notamment dans l’imagerie médicale, mais aussi un certain consumérisme de la santé bien installé dans les mentalités, que ce soit du côté des praticiens ou des patients, sans compter la pression, plus ou moins subtile, exercée par les industries pharmaceutiques ou d’appareillages médicaux.
En 2014, la FRC et ses consœurs ACSI et SKS entendent initier le débat auprès du grand public. Elles mèneront une campagne d’information et mettront sur pied, ces prochains mois, une série d’actions portant sur la sensibilisation à la surmédicalisation. Une problématique complexe et délicate à communiquer, qui ne doit pas être amalgamée avec une médecine au rabais mais clairement identifiée à des actes médicaux dont les bénéfices pour la santé n’ont pas été scientifiquement démontrés. Entretien avec le professeur Nicolas Rodondi, chef de la Policlinique médicale de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, qui fait partie, en Suisse, des médecins très actifs dans ce domaine, notamment en faisant de la recherche afin de limiter les check-up, les dépistages ou les médicaments aux patients pour lesquels l’efficacité a fait ses preuves.
Comment définiriez-vous, en quelques mots, la surmédicalisation?
Il s’agit de l’ensemble des examens et des soins qui n’apportent pas de bénéfices sur la santé des patients, voire entraînent des effets secondaires néfastes. Cette notion a récemment repris le devant de la scène aux Etats-Unis durant la première législature du président Barack Obama, alors que la réforme de la couverture maladie, appelée aussi Obamacare, était vivement débattue.
Conséquence de l’hyperspécialisation de la médecine et des avancées technologiques considérables de ces vingt dernières années, la surmédicalisation a aussi participé à l’explosion des coûts de la santé dans la plupart des pays industrialisés. Une prise en charge globale du patient, non ciblée sur un organe, s’avère nécessaire.
Pour identifier une problématique, encore faut-il la documenter. Existe-t-il suffisamment de recherches?
En 2010, un groupe de travail de la revue JAMA Internal Medicine (anciennement intitulée Archives of Internal Medicine, ndlr) a publié une série d’articles sur la surmédicalisation. Puis plusieurs associations médicales et l’organisation des consommateurs américaines Consumer Reports ont lancé la plate-forme Choosing Wisely, dont le but est d’identifier les dépistages et les prescriptions les plus souvent pratiqués mais inutiles (choosingwisely.org). S’inspirant de la démarche, la Société suisse de médecine interne générale (SSMI) en a listé une dizaine. D’ici fin janvier, elle sélectionnera cinq domaines de surmédicalisation sur lesquels données et études internationales sont scientifiquement inattaquables. Au printemps, la SSMI entamera un travail de sensibilisation auprès des médecins, puis de la population.
La propagation de maladies telles que le cholestérol, le diabète ou l’hypertension n’est-elle pas aussi poussée par l’industrie pharmaceutique?
Les causes sont multiples, et les études ont permis de mieux définir qui bénéficie des traitements. Mais on ne peut nier que la pression des industries pharmaceutiques et des appareils de diagnostic joue un rôle, par exemple sur l’élargissement des critères pour définir un problème de santé nécessitant une intervention. Il y a peu, l’American College of Cardiology a édicté de nouveaux critères de risques concernant les patients avec un taux trop élevé de cholestérol, émettant des recommandations pour le traitement par des statines. Avec ces lignes directrices, le nombre de personnes concernées pourrait doubler aux Etats-Unis, cela équivaut à un marché de 30% de la population!
Autre exemple: les maladies thyroïdiennes. En Suisse, quelque 500 000 personnes prendraient un traitement hormonal, et cela parfois durant plusieurs décennies. En Angleterre, c’est le troisième médicament le plus vendu. Or, selon une étude, les pratiques diffèrent considérablement d’un pays à l’autre: la majorité des médecins allemands prescrivent de la thyroxine pour des dysfonctions légères, environ un tiers des médecins en Suisse et presque aucun en Hollande…
Comment expliquez-vous une telle différence d’appréciation pour les problèmes de thyroïde?
La médecine moderne comprend aussi de nombreuses zones grises. Pour y remédier, il faut de bonnes études, qui permettent d’établir des recommandations solides. L’Union européenne a décidé de financer une grande recherche (trustthyroidtrial.com), qui inclut, actuellement, des patients à partir de 65 ans avec une fonction diminuée de la thyroïde, à Berne et à Lausanne. Cette étude, pilotée par notre clinique, vise à clarifier quels symptômes sont améliorés ou prévenus (fatigue, baisse de moral, faiblesse musculaire, mémoire, etc.) et quels patients bénéficient d’une substitution de thyroxine. Ainsi, il sera possible de cibler les traitements pour ceux qui en bénéficient vraiment.
Le dépistage du cancer de la prostate fait l’objet de critiques. Quel est votre avis?
Depuis 2012, certaines recommandations ne préconisent plus le dépistage systématique du cancer de la prostate par dosage dans le sang du PSA, une protéine spécifique de la prostate – 60% des plus de 50 ans dépistés en Suisse en 2007, ndlr. Cela fait suite aux résultats randomisés de deux études qui ne démontraient que peu de différences entre les patients à risque ayant subi un dépistage systématique et ceux sans dépistage. Les estimations sont floues, mais 17% à 66% de ces cancers découverts par dépistage seraient des cas de surdiagnostic, avec des cancers débutants sans conséquence pour la santé. La difficulté réside dans le dialogue avec le patient, habitué à recevoir toutes sortes de prescriptions, d’analyses et de traitements. Une étude a montré que si 90% des patients acceptent facilement un dépistage du PSA dans une prise de sang, cette proportion tombe à moins de 50% lorsque le médecin explique le rapport bénéfices-risques. C’est encourageant et démontre qu’une bonne information peut avoir une influence sur les actes de surmédicalisation.
AGIR
SOUTENEZ NOS ENQUÊTES. ON S'OCCUPE DU RESTE.
Preuves à l'appui, la FRC provoque des changements concrets. Faites un don.


Continuer ma lecture

Poker Menteur
Prouvé par la science: vraiment?

Cosmétiques
Choisir la meilleure crème solaire