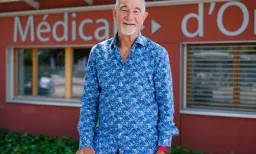L'invité
«La pénurie de généralistes va accélérer les compétences cliniques d’autres professionnels de la santé»
Archive · 27 juin 2023
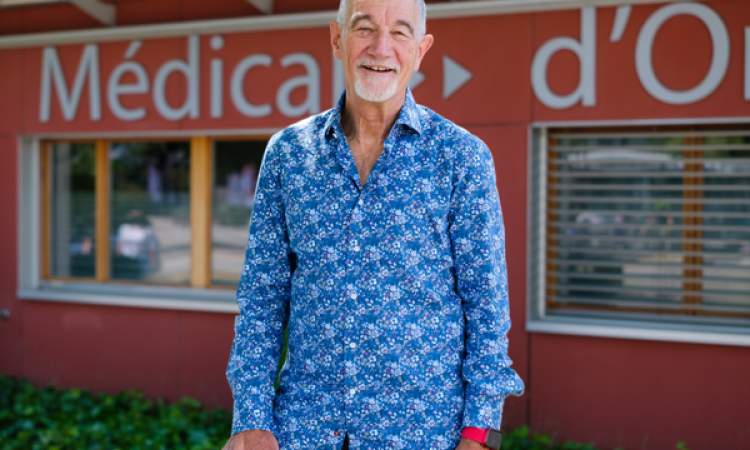
En novembre 2021, la FRC fournissait un nouvel indicateur – le nombre de coups de fil à passer avant de trouver un cabinet acceptant de nouveaux patients – pour rappeler que la pénurie de généralistes est une réalité qui frappe les patients au quotidien. La situation n’a pas vraiment évolué en dix-huit mois et, pour un second volet, nous nous sommes penchés sur les solutions mises en œuvre pour améliorer la médecine de premier recours. Le constat est mitigé: il existe des projets locaux, notamment dans les cantons de Vaud et de Genève, mais pas d’actions à l’échelle nationale. Pour autant, il ne faut pas (encore) désespérer. Point de la situation avec Philippe Schaller, médecin cofondateur du réseau de médecins de famille Delta, dont l’approche est pragmatique et quelque peu disruptive.
La pénurie de professionnels dans les soins de premier recours est connue de longue date et, malgré tout, aucun signe d’amélioration n’est en vue. Comment expliquer cela? Les raisons sont multiples. Tout d’abord, en Suisse, la formation d’un médecin de premier recours est relativement plus longue. Ensuite, la rémunération des médecins de famille, en comparaison des spécialistes, n’encourage pas cette filière. L’organisation du travail, entre vie de famille et activité professionnelle, est aussi plus difficile à réaliser. Les perspectives ne sont pas bonnes: actuellement, le taux est de 0,8 médecin pour 1000 habitants, c’est l’un des plus bas des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par ailleurs, la proportion de médecins de plus de 60 ans est élevée, et la féminisation du métier, si c’est une bonne nouvelle, entraîne une diminution en équivalent plein temps. Une étude prévoit, malheureusement, une diminution jusqu’à 20% du nombre de généralistes pour les prochaines années.
Des analyses constatent qu’en Suisse, les soins de premier recours dépendent encore trop des médecins et qu’il faudrait élargir le cercle des professionnels. Qu’en pensez-vous? Nous sommes en retard par rapport à d’autres pays. Malgré le vote en faveur des soins infirmiers, la promotion des autres professionnels reste encore bien timide. La pénurie programmée va accélérer la mise en valeur de ces derniers ainsi que le développement de leurs compétences cliniques; la pharmacie de quartier a également un bel avenir. Mais la valeur ajoutée réelle s’ancre dans l’intensification de la collaboration interprofessionnelle.
La Suisse accuse un retard important en matière de numérisation. Quel peut en être l’apport, quelles en sont les limites? Ce retard tient à la méfiance des Suisses à consentir à ce que leurs données soient collectées et partagées électroniquement ainsi qu’à la résistance des professionnels à utiliser un dossier médical partagé avec la crainte d’augmenter le travail administratif. Aujourd’hui, la priorité est nettement en faveur de la protection des données plutôt qu’aux avantages de la numérisation. Il est nécessaire de fournir des informations et des explications sur les avantages spécifiques des applications digitales en vue de l’amélioration de la qualité globale des soins et de l’efficience. Les patients font confiance à leur généraliste. Chacun d’eux pourrait jouer un rôle considérable en faveur d’une numérisation proportionnée et utile aux patients. Il est indispensable de donner confiance, d’assurer la sécurité des données et la transparence sur leur utilisation.
«Il faut laisser les soignants agir et innover dans la pratique quotidienne, leur permettre de faire des expériences de collaboration en les autorisant à déléguer des tâches.» Dr. P. Schaller
Mais sans interprofessionnalité la valeur ajoutée de ces outils est-elle la même? Effectivement, les avantages sont considérables pour le suivi d’un patient présentant une maladie chronique ou lors d’une situation sociale difficile qui demande l’intervention de nombreux professionnels. Dans ces situations, le partage d’informations au sein d’une équipe de soins interprofessionnelle assure une bonne coordination des actions à entreprendre et à planifier. Moins d’erreurs médicales, moins d’examens superflus, une communication plus rapide, donc plus de qualité et de satisfaction pour le patient.
Les conditions sont-elles réunies pour améliorer l’interprofessionnalité? Outre la numérisation, sur quels aspects doit-on travailler? Il faut laisser les soignants agir et innover dans la pratique quotidienne, leur permettre de faire des expériences de collaboration en les autorisant à déléguer des tâches. La formation et ce type d’échange sont, lors de situations concrètes, les plus efficaces pour faire avancer l’interprofessionnalité. Mais le temps consacré pour favoriser cette collaboration et assurer la coordination doit être rémunéré. Avec l’appui du canton de Genève, plusieurs projets pilotes ont été menés et évalués: il est possible d’améliorer cette interprofessionnalité et d’obtenir plus de satisfaction auprès des patients et des soignants tout en assurant une neutralité des coûts. Le taux d’hospitalisation inappropriée a également diminué.
Ce modèle implique un nouveau modèle de rémunération. Lequel? Le financement à la prestation est devenu obsolète et n’est plus adapté aux situations complexes que nous devons suivre au sein des cabinets de médecine générale. Le Tardoc (le nouveau tarif médical suisse, ndlr) apportera, certes, une amélioration mais qui restera insuffisante pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques et de la nécessité de promouvoir la prévention. De nouveaux modèles de financement des généralistes doivent rapidement être testés. Par exemple, le médecin recevrait une rémunération fixe pour chaque patient dont il a la charge, en lien avec la situation clinique et le temps à consacrer pour assurer la coordination de situations complexes.
Quels avantages a ce modèle de financement par tête? Il s’agit d’en tester la structure et d’en assurer la simplicité administrative, pour qu’il reste stimulant pour les soignants et réponde aux besoins des patients. Il doit permettre un meilleur accès et un meilleur suivi, en particulier des malades chroniques. L’abandon d’une tarification à l’acte signifie aussi un temps de consultation moins limité, puisque les soignants peuvent s’ajuster d’une situation à une autre et que les tâches seront partagées plus librement entre professionnels. Par ailleurs, en détachant la rémunération des actes, on sera plus à même d’éviter les sur- et sous-consommations de prescriptions qui sont la conséquence d’incitatifs négatifs. Enfin, ce modèle sera un levier formidable en matière de prévention: il s’agira avant tout de maintenir en bonne santé les patients et de leur assurer la meilleure qualité de vie possible.
La LAMal autorise des projets pilotes depuis 2023. Est-ce une aubaine pour tester ces modèles? Le Parlement et l’Office fédéral de la santé publique ont compris qu’il fallait favoriser l’expérimentation dans le cadre de la LAMal, les réformes en profondeur prennent beaucoup de temps avant de trouver des compromis entre toutes les parties prenantes. Nous avons, entre Arsanté et le réseau Delta, déposé un projet pilote selon l’article 59b avec l’Hôpital de Morges, en janvier. Nous souhaitons, avec ce dernier, revoir un certain nombre de principes, notamment dans le cadre de la coordination des soins, des modèles de rémunération des professionnels, de l’indispensable numérisation des soins ainsi que de l’utilisation et le déploiement de CARA, le dossier électronique du patient développé par les cantons romands. D’autres projets pourront tester les nouveaux rôles des pharmaciens et des infirmières en pratiques avancées et assurer au citoyen-patient une réelle place. Il est le principal concerné et doit être au centre pour donner son avis et gouverner le système de santé.
Flécher et coordonner les soins, c’est en partie renoncer à la liberté de choix du médecin. Que répondez-vous aux patients à qui ce renoncement fait peur? La liberté de choix doit être respectée. La difficulté en santé est de faire le bon choix, qu’il soit éclairé. Sur quels critères choisir son médecin traitant? Son chirurgien pour une intervention délicate? La relation de confiance est primordiale mais elle ne suffit pas à assurer la qualité des soins. Il est nécessaire d’avoir des informations objectives et comparées. Il est certain qu’une organisation de santé, publique ou privée, peut être un intermédiaire garant de la qualité et de l’éthique professionnelle.
Il est temps de désenclaver le système de santé
Les Suisses sont plus de 75% à avoir opté pour des modèles d’assurance alternatifs, en particulier le modèle «médecin de famille». Celui-ci les oblige à débuter tout parcours de soin auprès d’un généraliste. Un modèle vertueux, puisqu’une écrasante majorité des premières consultations se fait pour un motif qu’un médecin de famille peut régler.
Malheureusement, ces vertus ne sont que théoriques. Au quotidien, les obstacles sont nombreux: il faut trouver un généraliste qui prend de nouveaux patients, les cabinets se transforment en «agence à bons de délégation», la pénurie de soignants fait rage, et les cas urgents ou complexes en font les frais.
Les assureurs clament souvent que leurs modèles alternatifs sont la clé à des soins mieux coordonnés. Rien n’est plus faux: il existe des modèles très différents, certains intéressants, d’autres offrant des parcours labyrinthiques. Surtout, chaque automne, la FRC observe que le choix d’une compagnie et d’un modèle se fonde sur le prix des primes, non sur la qualité du parcours proposé. L’approche marketo-bureaucratique des caisses laisse penser qu’un réseau de soins est forcément un choix contraint sans réelle plus-value médicale.
Or les réseaux sont l’avenir. Si l’on veut maintenir la qualité de la prise en charge, faire face à la pénurie de soignants, tout en agissant sur les coûts, il faut unir les compétences et créer des passerelles. Tout ceci exige un cadre légal et tarifaire nouveau, mais pas seulement. On dit du système de santé qu’il est trop segmenté à cause du fédéralisme. La segmentation est aussi identitaire entre corps de métier, voire en leur sein: les parcours formatifs créent des prés carrés dans lesquels se perdent et les patients et la qualité des soins. Il est temps de désenclaver le tout et d’opter pour une approche plus intégrative et interprofessionnelle.
AGIR
SOUTENEZ NOS ENQUÊTES. ON S'OCCUPE DU RESTE.
Preuves à l'appui, la FRC provoque des changements concrets. Faites un don.


Continuer ma lecture

Poker Menteur
Prouvé par la science: vraiment?

Huile d'olive
Le comparatif des huiles d'olive