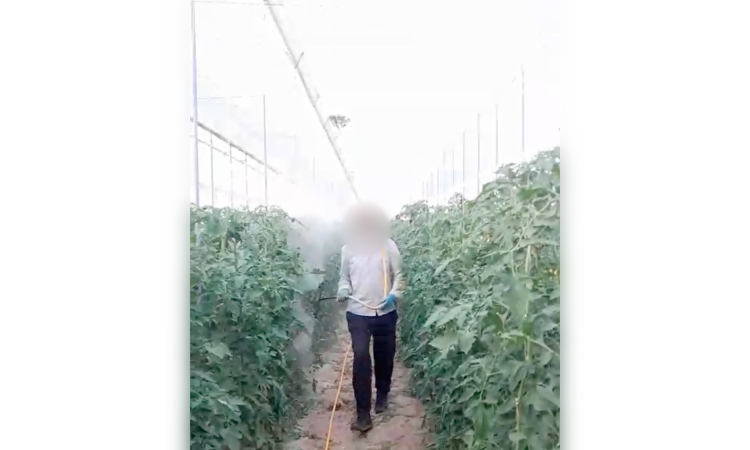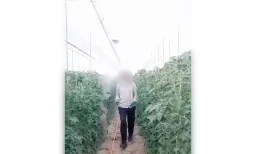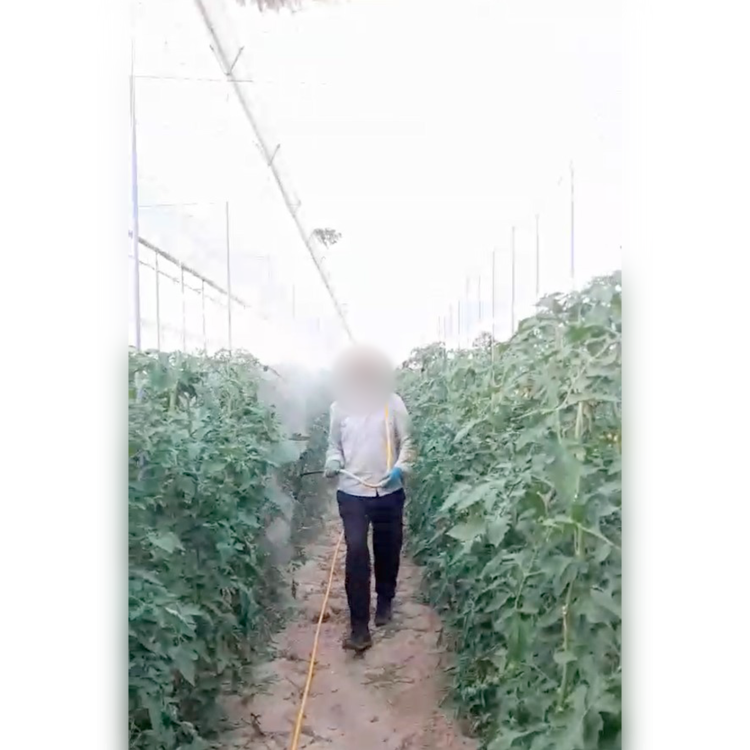Sharing economy
Concrètement, que faire?
Archive · 12 décembre 2016
- Les approches privilégiant le partage et le participatif, tout comme les transactions épisodiques doivent bénéficier de règles plus souples que les activités clairement assimilables à l’exercice d’une profession salariée du fait de leur intensité et/ou de leur chiffre d’affaires.
La nouvelle figure du prosommateur» (consommateur-prestataire) fait l’objet des principales interrogations. Son profil revêt diverses formes selon l’usage – occasionnel ou professionnel – de la : le particulier qui tire un avantage financier tout-à-fait accessoire ou l’indépendant qui en tirer la majorité de son revenu.
Tous deux ne peuvent et ne doivent pas être réglementés de la même manière. Des obligations trop élevées pour le prosommateur occasionnel remettrait en question toute l’innovation de l’économie du partage au sens strict du terme, alors qu’à l’inverse un régime trop léger pour le prosommateur professionnel légitimerait une concurrence déséquilibrée envers les acteurs «traditionnels».
- La législation doit permettre une distinction claire entre offres privées et professionnelles en établissant des critères faciles à comprendre et à appliquer. Par exemple des limites de temps ou de revenu.
La clé d’un système équilibré qui ne briderait pas l’innovation réside dans la progressivité des responsabilités, les obligations imposées aux prestataires devant dépendre de l’intensité de leur implication et des revenus qu’ils en tirent.
Certaines grandes villes vont dans ce sens en fixant un plafond à l’activité du prosommateur privé en se basant par exemple sur une fréquence de location maximale (60 jours par an à Amsterdam. Et Airbnb a même limité à 90 jours de location à Londres à moins que les logeurs aient expressément le droit de louer plus longtemps) ou sur un revenu maximal (le Parlement français planche sur une «franchise» d’environ 5’000 euros maximum tirés l’économie du partage, qui s’appliquerait particulièrement aux courses réalisées au travers d’Uber).
Au-delà de ces quotas, rien ne s’oppose à ce que le prosommateur soit considéré d’une autre manière par la législation et acquiert un autre statut, indépendant ou employé de la société, par exemple.
- La sécurité juridique des consommateurs qui veulent s’inscrire dans une logique de partage ou devenir épisodiquement un prestataire doit être améliorée et ils doivent disposer d’un système simple et convivial pour se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
L’innovation de l’économie du partage réside dans la facilité pour un utilisateur à devenir un prestataire («prosommateur») et cette caractéristique doit absolument être préservée.
Pour le consommateur-utilisateur, il n’est pas évident de savoir s’il a en face de lui une offre venant d’un prosommateur ou d’une entreprise, ce qui pose notamment des questions au niveau du règlement des litiges.
La solution pourrait passer par une catégorisation des prosommateurs simple à comprendre et à appliquer, par exemple en fonction du revenu qui est tiré de ces activités ou du nombre de jour consacré à ces plates-formes.
Le prosommateur rencontre encore trop de difficultés à respecter la loi: il est par exemple encore difficile de faire payer la taxe de séjour sur Airbnb ou bien de payer ses cotisations sociales chez Uber.
Les plates-formes devraient mettre en place des mécanismes pour que les consommateurs et prosommateurs puissent respecter facilement le droit en vigueur.
Airbnb a indiqué récemment mener des discussions avec les grandes villes dans le monde pour faciliter la collecte de la taxe de séjour. C’est un point positif, mais il serait également judicieux de mettre en place des procédures simplifiées pour les petites communes afin que les prestataires puissent facilement verser la taxe de séjour.
- Les règles qui visent à protéger le consommateur ou qui poursuivent un but d’intérêt public doivent être conservées, au contraire de celles qui visent à protéger artificiellement de la concurrence certains secteurs économiques ou corporations.
Afin de décider du maintien, de l’abandon ou de l’adaptation de certaines règles, les règlementations actuelles doivent par conséquent être analysées en fonction de leur objectif initial, de leur utilité dans ce nouveau paradigme et des éventuelles alternatives offertes par la technologie.
L’intérêt du consommateur et sa protection doivent guider cette adaptation du cadre légal.
- Le consommateur doit bénéficier d’un niveau de protection au moins aussi élevé dans l’économie digitale que dans l’économie traditionnelle. Contrairement à ce que prétendent certains, les nouvelles technologies ne rendent pas obsolètes les règles de protection des consommateurs et elles sont toujours autant nécessaires.
Certaines réglementations actuelles visent à protéger des corporations plutôt que les consommateurs. Il y a lieu de réfléchir si certaines règles peuvent être adaptées pour permettre une saine concurrence tout en préservant la protection du consommateur.
Par exemple, le tachygraphe ne devrait plus être l’unique moyen de décompter une course de taxi, mais il devrait pouvoir être possible d’utiliser un smartphone.
A contrario, il est nécessaire de conserver certaines règles relatives à la durée maximale d’une journée des chauffeurs afin de préserver la sécurité des clients.
La meilleure adéquation entre l’offre et la demande grâce à la géolocalisation devrait permettre de réduire les temps d’attentes des chauffeurs ; une modification du temps de travail maximum n’est donc pas nécessaire.
- Le consommateur doit recevoir une information claire sur l’identité et la nature privée ou professionnelle du prestataire, les droits et devoirs réciproques de chacun et le fonctionnement, y compris financier, de la plate-forme.
Lorsqu’un consommateur utilise une plate-forme, il lui est difficile de savoir à qui il a à faire: une entreprise qui met par exemple une multitude d’hébergement en location ou un simple propriétaire qui a une chambre en trop ?
La différence est pourtant cruciale notamment en lien avec l’application du droit actuel de la consommation, basée sur la relation traditionnelle entre consommateur privé et prestataire professionnel.
Les plates-formes doivent donc mieux différencier les offres et indiquer les caractéristiques du prestataire, ce que leur permet la puissance des outils actuels de traitement de données.
Le droit de la consommation doit aussi être adapté pour couvrir de manière appropriée les relations entre consommateurs et prosommateurs et offrir une vraie protection aux utilisateurs de l’économie de partage.
- Les données appartiennent aux consommateurs/prosommateurs et ils doivent connaître l’usage qui en est fait, pouvoir en disposer en tout temps («autonomie des données») et en obtenir sans difficulté la suppression et le transfert sur une autre plate-forme («portabilité»).
La maîtrise de ses données personnelles est essentielle pour que l’économie du partage puisse se développer sainement et bénéficier de la confiance de la population.
Pour participer au système d’évaluation, il est souvent nécessaire de dévoiler une grande partie de son identité.
Il est par conséquent primordial que ces données puissent être supprimées et/ou déplacées facilement sur une autre plate-forme si le consommateur le souhaite. Cette mesure est également nécessaire pour préserver une saine concurrence entre les différentes plates-formes.
En outre, il est primordial qu’une transparence totale soit donnée sur l’utilisation qui est fait de ces données, notamment sur leur éventuelle transmission, voire vente, à des tiers.
- Tous les acteurs économiques doivent être impliqués et aucun d’entre eux ne peut prétendre se soustraire à ses obligations. Les plates-formes qui mettent en contact consommateurs et prestataires doivent assumer le devoir de diligence qu’on est susceptible d’attendre d’elles en fonction du rôle qu’elles jouent dans les transactions, en particulier en termes de sécurité.
Actuellement, les plates-formes refusent d’assumer toute responsabilité en prétendant n’être que des intermédiaires qui mettent en relation deux parties, un consommateur-prestataire (le prosommateur) et un consommateur-utilisateur.
Or, il s’agit d’une relation économique triangulaire où chaque acteur a une responsabilité.
Il n’appartient pas aux organisations de consommateurs de trancher les débats qui concernent par exemple le statut des chauffeurs Uber (employés ou indépendants) ou les questions de marché du logement.
Par contre, il importe au consommateur de savoir si le chauffeur avec qui il voyage est en règle au niveau des assurances sociales et si son logeur respecte ses obligations fiscales.
Uber pourrait à cet égard faciliter la tâche des chauffeurs en trouvant des solutions faciles en matière de prévoyance professionnelle, mais aussi d’assurances en cas d’accident.
Des partenariats avec des assurances établies (comme le montre le cas de Sharoo) pourraient être une voie à suivre.
Les plates-formes doivent donc avoir des responsabilités, que l’on pourrait appeler «devoir de diligence».
La Finma l’a bien compris puisqu’elle a entamé des négociations avec les plates-formes de financement participatif (crowdfunding) pour que ces intermédiaires jouent un rôle accru afin de s’assurer que les transactions se passent bien.
Afin de ne pas brider les petites plates-formes, on peut attendre des exploitants de plate-forme une implication progressive et proportionnelle à leur taille et à leur modèle économique, sous la forme, par exemple, de vérifications des offres disponibles ou des personnes qui y souscrivent.
- Les plates-formes doivent notamment disposer d’un siège social ou d’une représentation en Suisse et mettre en place un service clientèle facilement accessible.
Aujourd’hui, il est par exemple extrêmement difficile de contacter Airbnb (qui a son siège en France), ce qui est inadmissible quand on pense à l’importance acquise par cet acteur économique dans le marché de l’hébergement.
Les associations membres de l’Alliance ne peuvent par ailleurs pas effectuer correctement leur travail de négociations avec les entreprises si ces plates-formes n’ont pas de représentation en Suisse.
En cas de litiges qui devraient aller jusqu’au tribunal, il est en outre bien plus compliqué de faire valoir les droits des consommateurs dans une autre juridiction nationale.
- Comme les systèmes de notation et d’évaluation jouent un rôle crucial dans l’économie digitale, leur crédibilité, leur véracité et leur caractère non-discriminatoire doivent faire l’objet d’une réglementation et d’un contrôle indépendant.
Il est très facile de créer plusieurs comptes pour avoir accès à ces plates-formes: dès lors, le système de notation n’est pas forcément fiable et peut être facilement contourné.
Les plates-formes devraient mettre en place des mécanismes transparents de vérification des commentaires et des offres afin de renforcer la légitimité des systèmes d’autoévaluation, car l’autorégulation n’est pas suffisamment crédible et forte pour se suffire à elle-même
- Une solution de règlement des litiges indépendante et facile d’accès doit être mise en place et son existence doit être indiquée directement sur la plate-forme.
Le règlement des litiges est le gros point d’interrogation de l’économie du partage.
En cas de problème, par exemple un vol d’objet dans un appartement partagé sur Airbnb ou un accident dans un véhicule Uber, il est nécessaire que consommateurs et prosommateurs puissent savoir rapidement et facilement le rôle que joue la plate-forme et comment faire pour régler un litige.
Une meilleure indication des droits et devoirs respectifs devrait donc avoir une place sur les sites internet des plates-formes.
Il est primordial que ce nouveau modèle économique ne donne pas lieu à un affaiblissement de la protection des consommateurs.
Airbnb propose certes ce type de médiation, mais les avis des clients sont très mitigés et relèvent plutôt qu’il s’agit d’une mesure «alibi» plutôt que d’un réel service au client.
La création d’un organe de médiation, type Ombudsman, pour l’économie du partage ou pour certains domaines en particulier (hébergement/transport/financement par exemple) pourrait être une solution.
Cela permettrait d’éviter des litiges coûteux tant pour les plates-formes que pour ses utilisateurs et prestataires et amènerait de la transparence et de la confiance dans les prestations fournies.
- De nouveaux monopoles numériques doivent être évités. Ces plates-formes ont certes besoin d’une certaine masse critique pour fonctionner, mais elles ne doivent pas pouvoir abuser de leur position dominante.
Même si ces plates-formes ont besoin d’atteindre une certaine masse critique d’utilisateurs pour offrir un service optimal, le législateur devrait veiller à empêcher l’émergence de nouveaux monopoles.
Car lorsqu’une entreprise a atteint une part de marché trop importante, il est très difficile voire impossible pour un concurrent d’émerger.
Des risques d’abus de position dominante peuvent donc apparaître et il est nécessaire que la Commission de la Concurrence ainsi que le Surveillant des prix puissent intervenir dans ce cadre-là.
Le problème d’une position monopolistique peut concerner en particulier les commissions perçues, car un prosommateur captif ne pourrait pas échapper à des hausses unilatérales.
Aujourd’hui, la ComCo ou le Surveillant des prix ne peuvent intervenir car il reste des «offres concurrentes», mais les hôtels privés ou les petites centrales de taxi ne pourront à terme pas rivaliser avec une entreprise qui détient la majorité des parts de marché…
AGIR
SOUTENEZ NOS ENQUÊTES. ON S'OCCUPE DU RESTE.
Preuves à l'appui, la FRC provoque des changements concrets. Faites un don.


Continuer ma lecture

Poker Menteur
Prouvé par la science: vraiment?

Cosmétiques
Choisir la meilleure crème solaire